PHOTOKINA 1976 : le LEITZ CORREFOT
C'est le premier système moderne de mise au point à travers l'objectif, par détection de la netteté dans un plan équivalent à celui du film.
Les schémas sont extraits de la revue "Le Nouveau Photocinéma" du 10/76 et 01, 02/79.
Le schéma général ci-dessus permet d'appréhender son fonctionnement. Le miroir principal semi-transparent laisse passer une partie de la lumière qui est renvoyée vers le bas par le miroir auxiliaire. A une distance équivalente à celle du plan du film, le rayon lumineux passe à travers une trame qui vibre horizontalement (donc coupe ce rayon lumineux à une fréquence donnée), et atteint les cellules photoréceptrices.

Voyons à quoi ressemble cette trame :
c'est une lame de verre optique dont la face supérieure est composée de microprismes alternativement transparent (2) puis recouvert d'un revétement noir mat (1).
Sa mise en mouvement est très simple : l'electro-aimant 7 attire l'aimant permanent 6 solidaire de la trame et bande le ressort 3, ce faisant l'aimant 2 ne maintient plus la bobine 1 dans son champ et celle ci coupe l'alimentation de l'electro-aimant 7. Le ressort 3 ramène la trame et le cycle recommence.
On peut voir sur le schéma les zones tranparentes 5 et opaques 6 ainsi que la lentille collectrice 8 et les cellules de détection en 9.
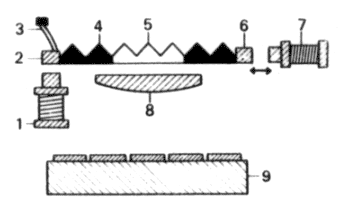
Selon la focalisation de l'image (ici pour faire simple un point lumineux), nous allons rencontrer trois cas : focalisation en avant du plan du film et donc de la trame, image floue se traduisant par une tache que les vibrations de la trame occultent alternativement pour une seule photodiode à la fois.
Focalisation sur le plan du film, image nette donc ponctuelle sur la trame et que les vibrations occultent alternativement pour les deux photodiodes en même temps.
Focalisation en arrière du plan du film et donc de la trame, image floue se traduisant par une tache que les vibrations de la trame occultent alternativement pour une seule photodiode à la fois.



Voila comment cela se traduit en
sortie des photodiodes (ou plutôt de leur amplificateurs). Quand les signaux
sont en phases, la mise au point est OK ; une image floue entraine un
déphasage, le sens de ce déphasage permet de savoir si la mise au point
est en avant
ou en arrière du plan de la trame.
Remarquons que la fréquence de vibration de la trame n'a pas besoin
d'une extrème précision
puisque seule la relation de phase entre les signaux est utilisée pour déterminée
la netteté.
Ces signaux, une fois analysés permettent l'affichage dans le viseur de
2 LEDs qui informe le photographe : les deux allumées, mise au point OK
; une seule allumée, mise au point en avant ou en arrière
selon que l'une ou l'autre des deux LEDs est active.

La réalisation du système présenté par Leitz
est extrèmement rustique, il s'agit plus d'une étude démontrant la validité
du concept qu'un prototype d'une prochaine production en série.
Le Correfot vu en 1976 est monté sur un boitier Leicaflex SL 2 à la place
de la cellule assurant la mesure "spot" ; le module optico-mécanique est
assez encombrant, il est fixé sous le boitier à la manière d'un winder,
et un cablage le relit à un volumineux ordinateur qui interpréte
les informations du Correfot.
A part la trame vibrante développé par Leitz, tous les autres éléments
proviennent de la grande série. Ainsi la barrette de photodiodes est de
provenance Siemens et comporte cinq cellules dont quatres sont utilisées,
les amplificateurs sont des Texas Instruments très classique, l'ensemble
n'est absolument pas intégré et donc volumineux. Mais cela revient infiniment
moins cher que de faire étudier un circuit intégré dédié.
Toutefois le système fonctionne très bien avec une grande précision, mais
l'utilisation de photodiodes non filtrées (donc sensible à l'infra-rouge)
a une curieuse conséquence : en intérieur sous éclairage à incandescence,
les infra-rouge sont présents en grande quantité et sont mesurés par le correfot
à la place de la seule lumière visible ! Et comme le montre l'index de mise
au point infra-rouge sur les objectifs, pour un même objet à une distance
donnée son image infra-rouge ne se focalise pas sur le même plan que son image
en lumière visible (sauf avec un vrai objectif Apo). Ainsi sous éclairage
à incandescence quand le correfot dis "mise au point OK", l'oeil à travers
le viseur voit l'image (en lumière visible) floue !
A part ce désagrément, dû à l'emploi de composant du commerce, le Correfot soulève de grand espoir. Ses cellules peuvent aussi mesurer l'exposition et une fois intégré dans un circuit spécifique, on peut obtenir un ensemble compact et performant.
 A
priori, la présence d'un élément mobile, donc sensible
au choc semble être un obstacle, mais le
vrai problème est dans la fabrication en petite quantité des
produits Leica,
les process
des
sous-traitants
en électronique sont prévus pour une tout autre échelle
: la quantité
minimale d'un lot de module AF est trop importante pour la production
de boitiers Leica. Et la fabrication de petit volume de puces électroniques
sur mesure a un prix de revient bien trop élevé, même pour Leitz. De
plus Leitz n'a pas les moyens financier de développer
son étude. Sans un
grand partenaire le développement
et la production du Correfot était impossible ; à l'époque
on pensait
à Minolta qui collaborait avec Leitz sur les télémétriques
et quelques objectifs
de la gamme R. Encore fallait il que la production en très grande
série
abaisse suffisament le prix
du
Correfot
pour le rendre compatible avec une gamme de boitier Minolta qui soit
suffisament abordable pour être largement diffusée.
A
priori, la présence d'un élément mobile, donc sensible
au choc semble être un obstacle, mais le
vrai problème est dans la fabrication en petite quantité des
produits Leica,
les process
des
sous-traitants
en électronique sont prévus pour une tout autre échelle
: la quantité
minimale d'un lot de module AF est trop importante pour la production
de boitiers Leica. Et la fabrication de petit volume de puces électroniques
sur mesure a un prix de revient bien trop élevé, même pour Leitz. De
plus Leitz n'a pas les moyens financier de développer
son étude. Sans un
grand partenaire le développement
et la production du Correfot était impossible ; à l'époque
on pensait
à Minolta qui collaborait avec Leitz sur les télémétriques
et quelques objectifs
de la gamme R. Encore fallait il que la production en très grande
série
abaisse suffisament le prix
du
Correfot
pour le rendre compatible avec une gamme de boitier Minolta qui soit
suffisament abordable pour être largement diffusée.
Finalement Minolta n'étendra pas sa collaboration au Correfot et Leitz aurait
recyclé son
système
dans des applications industrielles où la faible intégration
n'était
pas un obstacle.
Pendant ce temps, Honeywell a dû sentir le vent du boulet, le créateur du visitronic, ne renonce pas à l'adapter à une utilisation à travers l'objectif. Et c'est des bureaux d'études de ce grand de l'électronique que sortira le module AF à décalage de phases que nous connaissons aujourd'hui, un système sans élément mobile et au coût de production relativement faible.
